Le critère de la souffrance dans l’éthique animale anglo-saxonne
in Jean-Luc Guichet (dir.), Douleur animale, douleur humaine : données scientifiques, perspectives anthropologiques, questions éthiques, Paris, Quae, 2010, p. 191-199.
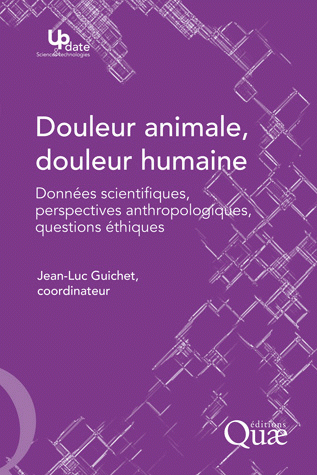
L’éthique animale est l’étude du statut moral des animaux pris individuellement, c’est-à-dire de la responsabilité des hommes à leur égard. La question est millénaire, mais c’est depuis une trentaine d’années et dans le monde anglo-saxon seulement qu’elle s’est constituée comme une discipline enseignée à l’université et alimentant des milliers de publications.
L’éthique animale est l’étude du statut moral des animaux pris individuellement, c’est-à-dire de la responsabilité des hommes à leur égard [1]. La question est millénaire, mais c’est depuis une trentaine d’années et dans le monde anglo-saxon seulement qu’elle s’est constituée comme une discipline enseignée à l’université et alimentant des milliers de publications. Si l’on précise qu’elle s’intéresse aux animaux pris individuellement, et non aux espèces en tant que telles ou aux écosystèmes, c’est pour la distinguer de l’éthique environnementale. Pourquoi ? Car seuls les individus souffrent. Le point de départ, la raison d’être de l’éthique animale est l’existence d’une souffrance animale. Si les animaux ne souffraient pas, s’ils n’avaient pas la capacité de ressentir la douleur, la question de leur statut moral, celle de notre responsabilité à leur égard, ne se poserait pas davantage que pour les arbres, les légumes, les roches ou les rivières. Il existe donc un lien consubstantiel entre considération morale et souffrance animale, qui constitue précisément le terrain de l’éthique animale.
Il faut d’emblée faire une précision terminologique. Comme d’autres dans ce recueil, nous ne souscrivons pas à la distinction traditionnelle entre la « douleur » seulement physique de l’animal et la « souffrance » éventuellement morale de l’homme. L’usage, pour une fois, a raison de les confondre et de les tenir pour synonymes, comme en témoigne le Dictionnaire historique de la langue française qui, étymologie à l’appui, définit la douleur comme une « souffrance physique ou morale » et la souffrance comme une « douleur physique ou morale » [2]. Nous partageons donc les doutes de Florence Burgat sur la pertinence de cette opposition classique. C’est une chose de considérer qu’il y a des différences entre les manières dont les animaux d’une part et les hommes d’autre part peuvent ressentir la douleur ou la souffrance. Il y a des différences, assurément, et nous verrons lesquelles. C’en est une autre, cependant, de répartir ces deux mots entre ces deux sujets, comme si la fracture était aussi simple. Nous utiliserons donc de façon générique le terme « souffrance ».
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si les animaux souffrent. Les rares néo-cartésiens qui se hasardent encore à nier l’existence d’une souffrance animale sont soit des théoriciens marginaux [3] soit des commerçants intéressés [4]. La question est plutôt de savoir quels animaux souffrent exactement, de l’éponge au chimpanzé, c’est-à-dire ce qu’il faut faire de la diversité du monde animal face à ce que nous appelons « souffrance » - mais ce problème extrêmement difficile voire insoluble (puisque la souffrance reste un vécu subjectif qu’il n’est pas toujours possible de mesurer objectivement) est souvent évacué par les acteurs de l’éthique animale qui n’ont pas besoin de prouver que tous les animaux souffrent ou quels sont ceux qui souffrent pour poser le principe relativement consensuel qu’il est faux de considérer que l’homme est le seul à souffrir. C’est donc en partant des cas peu discutables des animaux supérieurs – mammifères et oiseaux – que la plupart des auteurs bâtissent leur position. Il y a des animaux qui souffrent, au sens où nous l’entendons pour nous-mêmes, cela ne fait guère de doute, et la question qui subsiste est alors celle de savoir ce qu’il faut en faire, c’est-à-dire quelles doivent ou devraient être les conséquences de cette souffrance animale sur le comportement de l’homme qui y est confronté et qui, souvent, en est même responsable. C’est là le domaine de l’éthique animale et nous allons, dans ce bref article, tenter d’en présenter un rapide panorama.
La souffrance est un critère pertinent de considération morale
Le retournement qu’opère l’éthique animale anglo-saxonne par rapport à la tradition, c’est-à-dire essentiellement l’anthropocentrisme moral, consiste précisément à affirmer la pertinence de la souffrance comme critère de considération morale. La moralité traditionnelle identifie depuis deux millénaires les critères retenus pour fonder le statut de patient moral (auquel il est mal de faire du mal) et ceux que l’homme utilise pour se distinguer de l’animal, qui sont toujours des compétences intellectuelles (capacité de raisonner, d’avoir un langage articulé, une conscience réflexive, etc.) – comme si l’homme voulait se réserver à lui seul le statut de patient moral, avant même de savoir si les critères retenus sont véritablement pertinents. Il est ridicule, nous dit-on, d’entrer vis-à-vis des animaux dans une relation de justice, puisqu’ils ne peuvent pas la comprendre, qu’ils ne savent même pas de quoi il s’agit, qu’ils ne peuvent pas contracter, nous rendre la pareille, partager une réciprocité qui exige des compétences intellectuelles qu’ils n’ont pas. Voilà donc une bonne raison, dit la moralité traditionnelle, de ne pas les considérer comme des patients moraux, titulaires éventuels de droits, ou au moins envers lesquels nous aurions des devoirs.
On considère généralement que Jeremy Bentham a été le premier à produire une objection puissante à ce raisonnement commun. En vérité, Rousseau avant lui avait déjà exprimé en substance l’argument qui est aujourd’hui repris par la plupart des acteurs de l’éthique animale anglo-saxonne :
« Il semble, en effet, que, si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c’est moins parce qu’il est un être raisonnable que parce qu’il est un être sensible : qualité qui, étant commune à la bête et à l’homme, doit au moins donner à l’une le droit de n’être point maltraitée inutilement par l’autre » [5].
C’est la révolution copernicienne qui est l’origine de l’éthique animale contemporaine : la considération morale ne tourne plus autour de la raison, mais de la sensibilité, c’est-à-dire de la capacité de souffrir. C’est ce que confirme Bentham dans ce passage fameux et abondamment cité :
« Quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable ? Est-ce la faculté de raisonner, ou peut-être celle de discourir ? Mais un cheval ou un chien adulte est un animal incomparablement plus rationnel, et aussi plus causant, qu’un enfant d’un jour, ou d’une semaine, ou même d’un mois. Mais s’ils ne l’étaient pas, qu’est-ce que cela changerait ? La question n’est pas : Peuvent-ils raisonner ? ni : Peuvent-ils parler ? mais : Peuvent-ils souffrir ? » [6].
L’exemple du nourrisson est une manifestation de ce que l’on appelle aujourd’hui « l’argument des cas marginaux », qui se retrouve notamment chez Singer, Regan, Cavalieri et la plupart des auteurs [7]. Il consiste à dire que si les critères intellectuels habituels étaient véritablement pertinents pour fonder la considération morale, nous n’aurions pas de considération envers les êtres humains marginaux, comme les nourrissons, les séniles, certains handicapés mentaux, qui ont encore moins de capacités intellectuelles que certains animaux. Si nous nous abstenons de les faire souffrir, ce n’est pour aucune des raisons subtiles que nous mobilisons quand il s’agit de justifier notre absence de considération envers les animaux, et qui sont ces critères intellectuels traditionnels. C’est pour une raison beaucoup plus simple : parce qu’ils sont doués de la capacité de souffrir. La performance intellectuelle du sujet n’est d’aucune utilité quand il s’agit de savoir s’il est légitime ou pas de lui infliger une douleur physique, comme le notait déjà Sidgwick : « la différence de rationalité entre deux espèces d’êtres sensibles ne permet pas d’établir une distinction éthique fondamentale entre leurs douleurs respectives » [8]. La présence de la souffrance, par contre, est un critère pertinent de considération morale. Mais est-il nécessaire et suffisant ?
La souffrance est-elle un critère nécessaire et suffisant ?
En éthique animale, la souffrance est a priori un critère nécessaire, car elle est précisément ce qui donne à ce domaine son identité propre, par rapport à l’éthique environnementale qui peut, elle, accorder une considération morale directe à des êtres vivants non sensibles, tels que les végétaux, à des entités supra-individuelles comme les forêts, les espèces, les écosystèmes, et au monde abiotique. Certains auteurs, comme Martha Nussbaum, discutent néanmoins cette nécessité, arguant notamment que la sensibilité, ici entendue comme capacité de souffrir, a le tort de négliger « la variété des capacités et des activités animales, et donc certaines zones de dommages à l’épanouissement qui ne sont pas déclarés comme douleur ». C’est la raison pour laquelle Nussbaum défend une approche disjonctive selon laquelle « si une créature a soit la capacité de ressentir le plaisir et la douleur ou la capacité de se mouvoir d’un endroit à l’autre ou la capacité d’éprouver des émotions et de l’attachement ou la capacité de raisonner, et ainsi de suite [], alors cette créature a un statut moral ». On pourrait croire, à l’issue de cette énumération et si l’on suppose que la disjonction est exclusive, que Nussbaum présente la capacité de souffrir comme un critère parmi d’autres, qui ne serait donc pas particulièrement nécessaire. Ce n’est pas le cas car, dans les faits, toutes les créatures qui ont les qualités susdites ont aussi la capacité de ressentir le plaisir et la douleur, puisque « la sensibilité joue un rôle essentiel dans le mouvement, l’attachement, l’émotion et la pensée » [9]. Par conséquent, le premier critère de la liste, qui est la capacité de souffrir, accompagne nécessairement tous les autres. L’auteur ne dit pas que la capacité de souffrir n’est pas un critère nécessaire de la considération morale, mais plutôt qu’elle n’est pas le seul critère pertinent. Et si la sensibilité apparaît comme une condition nécessaire de la considération morale, ce n’est pas parce qu’elle est le seul critère pertinent, mais plutôt parce qu’elle est la condition de tous les autres critères, la condition de toutes les autres conditions de la considération morale.
Est-elle, maintenant, un critère suffisant ? C’est ici, surtout, que les auteurs divergent. Certains se contentent de la sensibilité, à laquelle on adjoint souvent la conscience – ce qui ne complique la tâche qu’en apparence. Lorsque Frankena, par exemple, écrit que « Tous les êtres qui sont capables d’éprouver du plaisir, de la douleur, de la joie, de la souffrance, de la peur, de l’espoir, etc. – en bref, qui sont capables de sentir et d’avoir des expériences conscientes – sont dignes de considération morale pour eux-mêmes, du moins si nous pouvons influencer ce qui leur arrive par ce que nous sommes volontairement ou par ce que nous faisons » [10], il ne faut pas concevoir la capacité d’avoir des expériences conscientes comme un critère différent et supplémentaire par rapport à la simple capacité de souffrir puisque, comme nous l’avons précisé en introduction, la raison pour laquelle nous refusons de distinguer souffrance et douleur est précisément qu’elles impliquent forcément une forme de conscience, un ressenti qui n’est jamais purement physique.
Ceux qui considèrent la capacité de souffrir, conscience incluse, comme un critère suffisant de considération morale sont généralement des utilitaristes [11] qui raisonnent en termes d’intérêts et qui cherchent à maximiser le bien-être animal (animal welfare) en minimisant la souffrance. La figure la plus connue de ce courant est bien entendu Peter Singer : « c’est le critère de la sensibilité […] qui fournit la seule limite défendable à la préoccupation pour les intérêts des autres » ; « pour défendre les conclusions qui sont argumentées dans ce livre [Animal liberation] le principe de réduction maximale de la souffrance suffit » [12]. Ceux qui, au contraire, considèrent que la capacité de souffrir n’est pas un critère suffisant de considération morale et ajoutent d’autres exigences sont généralement des déontologistes [13] qui raisonnent en termes de droits et qui attribuent des droits moraux et/ou légaux aux animaux (animal rights). Pour Regan, par exemple, le critère de considération morale n’est pas la seule capacité de souffrir, mais la valeur inhérente d’individus qui sont sujets-d’une-vie (subject-of-a-life) « s’ils ont des croyances et des désirs, s’ils sont doués de perception, de mémoire et d’un sens du futur incluant leur propre futur, s’ils ont une vie émotionnelle faite de plaisirs et de peines, des préférences et des intérêts au bien-être, la capacité d’entreprendre une action pour atteindre leurs désirs et leurs buts, une identité psychophysique à travers le temps et un bien-être personnel dans le sens où l’on peut dire que leurs expériences leur réussissent ou pas [que leur vie se déroule bien ou mal] de manière logiquement indépendante de leur utilité pour les autres et du fait qu’elles puissent satisfaire l’intérêt de quelqu’un d’autre » [14]. Définition relativement étroite, qui ne concerne dans les faits que les mammifères âgés d’un an et plus, en laissant de côté la question de savoir ce qu’il en est des animaux moins évolués. Pour Wise, également, la capacité de souffrir n’est pas un critère suffisant de considération morale : il lui ajoute l’exigence d’être titulaire d’une « autonomie pratique », c’est-à-dire la capacité de partager certaines tâches cognitives avec les humains (par exemple réussir le test du miroir, qui ferait la preuve d’une conscience de soi) [15]. Définition encore plus étroite, qui ne laisse passer que les humains, certains grands singes (chimpanzés, bonobos, orangs-outans, gorilles), les dauphins et les éléphants.
Ce qu’implique la commune capacité de souffrir des hommes et des animaux
Les animaux, au moins certains d’entre eux (laissons de côté la question des cas-limites), partagent donc avec les humains la capacité de souffrir. Cette communauté n’implique pas une identité entre les souffrances respectives des uns et des autres, ni même d’ailleurs au sein de chacun de ces groupes. On peut noter deux différences essentielles. La connaissance humaine, d’une part, qui permet notamment de se représenter la souffrance, peut elle-même être source de souffrance, ce qui double la charge : le condamné à mort souffre de savoir qu’il va mourir dans six mois, tandis que le bœuf l’ignore. L’ignorance animale, d’autre part, peut également être source de souffrance, puisque l’animal sauvage, par exemple et contrairement à l’homme, ne peut pas distinguer entre une tentative de le capturer pour le détenir et une tentative de le tuer. Ceci étant dit, ce qui intéresse l’éthique animale au-delà de ces différences est ce que partagent les hommes et les animaux et, surtout, ce que cette commune capacité de souffrir implique pour les premiers relativement aux seconds.
Singer, notamment, en déduit qu’ « il est impossible de justifier moralement le fait de considérer la douleur (ou le plaisir) que ressentent les animaux comme moins importante que la même quantité de douleur (ou de plaisir) ressentie par un être humain » [16]. Cette commune capacité de souffrir implique donc une égalité de considération. De là, il est important d’éviter deux confusions. D’abord, l’égalité de considération que prône Singer n’est pas l’égalité de traitement. Ce sont les intérêts de chaque être qui sont pris en compte, et avoir une égale considération pour des individus ayant des intérêts différents peut évidemment conduire à un traitement différent : « La préoccupation pour le bien-être des enfants qui grandissent aux États-Unis peut exiger que nous leur apprenions à lire ; la préoccupation pour le bien-être des cochons peut ne rien impliquer d’autre que de les laisser en compagnie d’autres cochons dans un endroit où il y a une nourriture suffisante et de l’espace pour courir librement » [17]. Ensuite, l’égalité de considération n’est pas l’égalité des vies. C’est ici qu’apparaissent les limites du critère de la souffrance. L’égalité de considération ne vaut que lorsqu’il s’agit de la souffrance, et non de la vie des êtres en question. Car, en matière de souffrance, le fait que l’homme soit par ailleurs plus intelligent, plus raisonnable, plus libre si l’on veut que l’animal n’a aucun impact sur leur intérêt commun à ne pas souffrir (tant que les capacités cognitives humaines n’augmentent pas le degré de souffrance). Par contre, cela a un impact sur leur intérêt à vivre, comme le montre l’exemple suivant. Si nous avions le choix entre sauver la vie d’un humain normal et celle d’un humain handicapé mental, nous choisirions probablement de sauver la vie de l’humain normal (ce faisant, on présuppose que sa vie vaut plus la peine d’être vécue que celle de l’autre). Mais si nous avions le choix entre faire cesser la douleur soit chez l’un soit chez l’autre, il serait beaucoup plus difficile de se décider (ce faisant, on présuppose qu’ils ont un intérêt égal à ne pas souffrir). Pourquoi ? Car on estime que tuer un être rationnel, capable de penser abstraitement et d’élaborer des projets revient à lui ôter davantage que la vie, à le priver de l’accomplissement de ses efforts. Singer conclut donc que « Cela signifiera en général que s’il nous faut choisir entre la vie d’un être humain et celle d’un autre animal nous devons sauver celle de l’humain ; mais il peut y avoir des cas particuliers où l’inverse sera vrai, quand l’être humain en question ne possède pas les capacités d’un humain normal » [18].
Bien entendu, un certain nombre d’auteurs ne sont pas d’accord avec cette position, qui n’accorde aucune valeur inhérente à la vie en elle-même, comme le rappelle Frankena, proche de Singer : « je n’arrive pas à comprendre dans quel sens la pure vie soit intrinsèquement bonne ou mauvaise ; […] un organisme doit être plus que seulement vivant pour avoir un droit de continuer à vivre. Sa vie doit avoir, ou être capable d’avoir, certaines autres qualités, comme la conscience, le plaisir, etc. » [19]. Tous les déontologistes qui défendent le caractère sacré de la vie, ceux-là mêmes qui s’opposent dans d’autres domaines de la bioéthique à l’avortement ou à l’euthanasie, dénoncent le manque de profondeur et les dangers de l’utilitarisme [20]. En éthique animale, Regan considère que l’utilitarisme « échoue à fournir une base adéquate en toute rigueur au devoir direct prima facie de ne pas faire mal » [21] et pourrait ainsi conduire à une légitimation du meurtre, à condition que celui-ci reste secret. C’est également l’objection classique déjà soulevée par Nozick avant même la parution du livre de Singer : « l’analyse utilitariste considèrerait-elle comme acceptable de tuer les animaux de façon indolore ? Serait-il acceptable […] de tuer les gens sans douleur, de nuit, pourvu qu’on ne l’annonce pas auparavant ? » [22]. Mais Singer y a répondu en évoquant l’intérêt à vivre des êtres capables d’avoir des projets. D’ailleurs, tout dépend des intérêts mis en balance, c’est-à-dire de la raison pour laquelle on tuerait sans douleur. Pour certains théoriciens des droits, comme Feinberg, l’abattage sans douleur n’est critiquable que s’il est gratuit, c’est-à-dire sans aucune raison valable : « L’abattage sans douleur et sans aucune raison, plus évidemment encore que le sport de chasse ou l’amusement, serait une invasion des droits de la victime » [23]. Par contre, l’abattage sans douleur pour se nourrir, par exemple, est acceptable. C’est que Feinberg, contrairement à Regan et à Francione, est un réformiste welfariste et non un abolitionniste. Francione passe en revue tous les types d’exploitation animale qui sont couramment considérés comme des usages acceptables ou nécessaires afin de montrer qu’il n’en est rien et que l’abattage, avec ou sans douleur, est toujours condamnable. La source du problème, selon lui, réside dans le statut juridique de l’animal, considéré comme un bien dont on peut se rendre propriétaire, comme une chose, et son but est donc d’étendre les droits moraux à des droits légaux qui protégeraient les animaux comme des personnes, et non des objets.
L’utilitarisme et le déontologisme ont en commun d’être des approches rationnelles, qui évaluent moralement l’action en termes de justice et de droit. De nombreux auteurs ne partagent pas cette attitude et abordent la question de la souffrance animale par d’autres chemins. Certains accordent une plus grande importance à l’intuition, au bon sens et à la moralité courante. On peut considérer que Midgley, Sapontzis, Clark, Habermas et les pragmatistes américains sont, de ce point de vue, intuitionnistes [24]. Clark, par exemple, explique que « Ceux qui battent les chiens à mort font quelque chose que la société devrait condamner sans attendre de savoir si le chien a des droits abstraits et métaphysiques » [25] - en vertu même du principe minimal et accessible à tous selon lequel il est mal de causer un mal évitable, intuition morale à peu près universellement partagée, que Bernstein exprime autrement : il est mal de faire souffrir gratuitement un innocent [26]. Principes généreux et indiscutables, mais un peu trop simplistes peut-être pour s’appliquer facilement à la réalité de nos rapports avec les animaux, puisqu’il y a évidemment des cas dans lesquels causer un petit mal peut créer un plus grand bien. D’autres auteurs développent une éthique de la sollicitude (care ethics) qui accorde d’autant plus d’importance au critère de la souffrance qu’elle valorise l’émotion plutôt que la raison. Leur indignation face à la souffrance animale n’est pas causée par une comparaison rationnelle qui établirait qu’il est injuste d’accorder des considérations différentes à des êtres ayant les mêmes intérêts placés dans les mêmes situations, mais par un sentiment direct, qui est la sympathie pour les animaux : « Ma condamnation morale de ces actions provient directement de ma sympathie pour les animaux ; elle est indépendante de la question de savoir si les humains sont protégés de tels abus » explique Luke [27]. Reste à prouver que les humains éprouvent effectivement une sympathie naturelle, et non socialement construite, pour les animaux – ce qu’entreprend Luke, contre les partisans d’une éthique de la justice, comme Singer et Regan.
L’image de la souffrance : dissimulation et mise en scène
Ce rapide et schématique tour d’horizon du rôle du critère de la souffrance dans l’éthique animale anglo-saxonne serait incomplet si nous ne consacrions pas quelques lignes à une approche plus sociologique que philosophique et qui, à notre avis, est indissociable des débats moraux. La souffrance animale n’est pas qu’un concept, elle est aussi et surtout une réalité que nous appréhendons à travers une construction sociale et un filtre médiatique. Dès lors, la manière dont les philosophes abordent la question – malgré leurs efforts pour le faire dans les termes les plus abstraits – dépend en partie au moins du contexte dans lequel la souffrance animale « apparaît » dans nos sociétés, c’est-à-dire plus exactement est présentée.
Si l’éthique de la sollicitude existe et a même un certain succès, c’est qu’elle réagit directement aux stratégies d’exclusion mises en œuvre dans nos sociétés pour justifier l’exploitation animale et ses abus, tout en modérant la culpabilité des acteurs et des spectateurs, c’est-à-dire en excluant l’animal de notre sympathie et, du même coup, de notre considération morale. Ces stratégies, outre l’anthropocentrisme lui-même qui en infériorisant l’animal permet à l’homme de se distancier de lui émotionnellement, se composent notamment de ce qui peut apparaître comme des « discours-alibis » (les alibis historique, alimentaire, économique, thérapeutique, l’appel à la tradition, etc.) et de trois stratagèmes. Le premier est la négation des torts causés, que Chapouthier appelle le déguisement de la réalité, qui passe d’abord par la dissimulation de la souffrance animale, derrière les portes des laboratoires ou dans les grands baraquements de l’élevage industriel, et ensuite par l’euphémisation, puisque les chasseurs « récoltent », les chercheurs « euthanasient » ce qui n’est jamais que du « matériel biologique » tandis que les abattoirs ne sont que des « unités de transformation d’aliments ». Dans tous les cas, et bien d’autres encore, la souffrance animale est dissimulée ou déguisée sous une terminologie plus propre, abstraite, agricole ou mécanique. Le deuxième stratagème est le découpage des responsabilités, c’est-à-dire la division du travail : « les abatteurs ne sont pas responsables de l’abattage puisque les consommateurs leur réclament de la viande et les consommateurs ne ressentent aucune responsabilité puisque la viande leur arrive dans un petit morceau de plastique d’une façon complètement neutre » [28]. Le troisième stratagème, enfin, est la dévalorisation de la sympathie pour les animaux : il consiste tout simplement à présenter la défense des animaux, ce que l’on pourrait appeler d’une manière large le mouvement « animaliste » dans son ensemble, comme une attitude irrationnelle, sentimentale et juvénile, faible, féminine parfois (c’est l’association classique entre insensibilité et virilité, qui fonde en partie la réaction écoféministe) [29], ridicule toujours. Il faut reconnaître que la critique est quelquefois méritée, tant certaines associations – à leur tour et dans le but inverse – mettent en scène la souffrance animale, à grands renforts d’images choquantes et de raisonnements fallacieux. Dans un cas comme dans l’autre, la souffrance animale est toujours instrumentalisée.
Cette situation a permis l’éclosion, en éthique animale, d’une approche politique elle-même composée de plusieurs courants. L’approche libérale est assez répandue dans le milieu anglo-saxon. Nussbaum écrit notamment que sa position sur les animaux et, plus généralement, sur les êtres placés aux « frontières de la justice » comme le titre son livre, est « une forme de libéralisme politique » [30]. Le conservatisme, quant à lui, insiste sur la responsabilité des hommes à l’égard des animaux dans une approche paternaliste ; le communautarisme, sur la notion de partage d’un code moral et le socialisme sur la protection du faible, comme l’explique Robert Garner qui, dans un livre consacré aux théories politiques des droits des animaux, s’oppose à la vision libérale classique [31]. Les partisans de la perspective socialiste, lisant l’exploitation animale comme un révélateur des abus du capitalisme, font alors une critique vigoureuse de la manière dont les principaux vecteurs que sont les médias, l’école, l’État, les religions, mais aussi les musées et la famille, présentent l’animal. « Tout ce que nous savons sur les animaux, écrit Nibert paraphrasant Stephen Jay Gould, nous le voyons avant tout dans les termes des compagnies commerciales » [32]. Et il y a des similitudes frappantes entre l’exploitation des animaux et celle des humains « dévalués », qui font dire à l’auteur qu’elles se renforcent l’une l’autre, faisant partie d’un même processus de « domestication ».
Ces approches sont intéressantes dans la mesure où elles rappellent que la souffrance animale n’est pas un donné univoque sur lequel il serait aisé de bâtir telle ou telle théorie morale, mais un construit plurivoque, pour ne pas dire ambigu, dont l’appréhension implique d’abord et avant tout un épluchage sociologique qui pourrait bien révéler, en fin de compte, que la communauté corporelle entre l’homme et l’animal, cette communauté de souffrance, est plus intime et imbriquée que l’on ne croit, ou qu’on voudrait nous faire croire.
BIBLIOGRAPHIE
CARRUTHERS P. [1992], The Animal Issue : Moral Theory in Practice, Cambridge, Cambridge University Press.
DOMBROWSKI D. 1997, Babies and Beasts : The Argument from Marginal Cases, Urbana, University of Illinois Press.
FRANCIONE G. [2008], Animals as Persons : Essays on the Abolition of Animal Exploitation, New York, Columbia University Press.
FRANKENA W. [1983], « Il diritto alla vita degli esseri non-umani », Rivista di filosofia 74:1-3, 2-42 ; trad. A. Bondolfi, L’homme et l’animal : dimension éthique de leur relation, Fribourg, Éditions universitaires, 1995, p. 112-131.
GARNER R. [2005a], Animal Ethics, Cambridge, Polity Press.
GARNER R. [2005b], The Political Theory of Animal Rights, Manchester, Manchester University Press.
HARRISON P. [1991], « Do Animals Feel Pain ? », Philosophy, 66, p. 25-40.
JEANGENE VILMER J.-B. [2008], Éthique animale, préface de Peter Singer, Paris, PUF.
LUKE B. [1996], « Justice, Caring, and Animal Liberation », in C. J. Adams et J. Donovan (ed.), Beyond Animal Rights : A Feminist Caring Ethic for the Treatment of Animals, New York, Continuum, 1996, p. 77-102 ; trad. dans les Cahiers antispécistes, 23, décembre 2003 (en ligne).
NIBERT D. [2002], Animal Rights / Human Rights. Entanglements of Oppression and Liberation, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers.
NUSSBAUM M. [2006], Frontiers of Justice : Disability, Nationality, Species Membership, Cambridge, Harvard University Press.
REGAN T. [1983], The Case for Animal Rights, Berkeley, University of California Press
SINGER P. [1993], La libération animale, seconde édition [1ère éd. 1975 non traduite en français], trad. L. Rousselle, Paris, Grasset.
SINGER P. [2007], « La pertinence de Mill aujourd’hui : un point de vue personnel », conférence prononcée à Londres le 6 avril 2006 ; traduit dans les Cahiers Antispécistes 28, p. 39-56.
SUNSTEIN C. et M. NUSSBAUM (ed.) [2004], Animal Rights. Current Debates and New Directions, Oxford, Oxford University Press.
[1] Pour tout développement des thèmes, des concepts et des auteurs cités dans cet article, nous renvoyons à notre ouvrage Éthique animale, préfacé par Peter Singer, Paris, PUF, 2008.
[2] Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992.
[3] P. Harrison [1991] et P. Carruthers [1992].
[4] Simon Casas, directeur des arènes de Nîmes, qui affirme notamment que « dans l’arène, rien ne prouve qu’il [le taureau] souffre » (L’Express, 19 juillet 2004, p. 68).
[5] J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, Aubier, 1973, p. 59.
[6] J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, XVII, §I, IV, note 1, Oxford, Clarendon Press, 1907, p. 311.
[7] Voir D. Dombrovski [1997].
[8] H. Sidgwick, « The Establishment of Ethical First Principles », Mind, 4:13, 1879, p. 106-107.
[9] M. Nussbaum [2006], p. 94 et 362.
[10] W. Frankena [1983], p. 118.
[11] L’utilitarisme est une approche d’origine anglaise (Bentham, Mill, Sidgwick) selon laquelle une action est bonne lorsqu’elle maximise le bien-être de l’ensemble des individus concernés. Le représentant actuel le plus fameux de ce courant est Peter Singer, qui défend un « utilitarisme des préférences » selon lequel « une action est bonne quand elle maximise la satisfaction des préférences, et mauvaise quand elle empêche ou frustre la satisfaction des préférences » (P. Singer [2007], p. 41). L’utilitarisme, qui se décline en plusieurs familles, est lui-même une sorte de conséquentialisme, qui consiste à évaluer moralement l’action en fonction de ses conséquences : une action est moralement bonne si elle produit les meilleures conséquences possibles.
[12] P. Singer (1993(, p. 39 et 56.
[13] Le déontologisme (du grec deon, devoir), est une approche d’origine kantienne selon laquelle une action est moralement bonne si elle est accomplie par devoir ou par respect pour la loi. Contrairement à l’utilitarisme, elle suppose l’existence objective et a priori de certaines obligations morales, qui sont universelles, c’est-à-dire valables pour tous. Les actes ont une valeur intrinsèque : ils sont bons ou mauvais en eux-mêmes, indépendamment des sujets et des conséquences. En éthique animale, les déontologistes les plus connus sont Tom Regan et Gary Francione, qui sont des théoriciens des droits des animaux – contrairement à Peter Singer qui ne parle pas de droits mais d’intérêts.
[14] T. Regan (1983(, p. 243.
[15] S. Wise, in C. R. Sunstein et M. C. Nussbaum (ed.) [2004], p. 19-50.
[16] P. Singer [1993], p. 42.
[17] Ibid., p. 35.
[18] Ibid., p. 56.
[19] W. Frankena [1983], p. 123.
[20] Voir notamment R. Scruton, Animal Rights and Wrongs, third edition, London, Demos, 2000.
[21] T. Regan (1983(, p. 228.
[22] R. Nozick, Anarchie, État et utopie, Paris, PUF, 1988, p. 62.
[23] J. Feinberg, Rights, Justice, and the Bounds of Liberty, Princeton, Princeton University Press, 1980, p. 201.
[24] Voir J.-B. Jeangène Vilmer [2008], p. 84-91.
[25] S. Clark, dans un dépliant de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, la SPA britannique), On the side of the Animals.
[26] M. Bernstein, Without a Tear : Our Tragic Relationship with Animals, Urbana, University of Illinois Press, 2004, p. 7.
[27] B. Luke [1996].
[28] G. Chapouthier, Les droits de l’animal, Paris, PUF, 1992, p. 70.
[29] Sur l’écoféminisme en éthique animale, voir J.-B. Jeangène Vilmer [2008], p. 118-120.
[30] M. Nussbaum [2006], p. 388.
[31] R. Garner [2005b], p. 157.
[32] D. Nibert [2002], p. 208.


