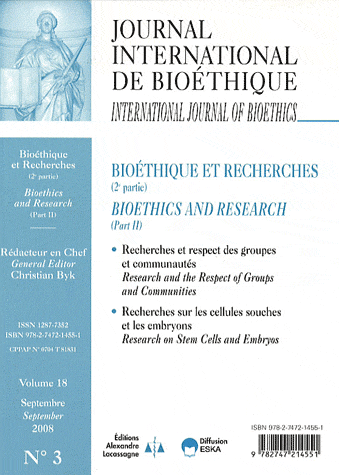
L’éthique animale n’est pas un ensemble de règles sur la conduite à adopter à l’égard des animaux avec lesquels nous interagissons mais un domaine de recherche qui a pour objet l’étude de la responsabilité morale des hommes à l’égard des animaux pris individuellement. Cet article le présente à travers plusieurs fractures : celle entre l’humanisme français et l’éthique animale anglophone, celle entre l’approche par la justice et l’approche par la compassion, celle entre l’abolitionnisme et le welfarisme, et celle entre ceux qui parlent de droits des animaux et ceux qui préfèrent parler d’intérêts.
L’éthique animale est l’étude de la responsabilité morale des hommes à l’égard des animaux pris individuellement (Jeangène Vilmer, 2011a). Elle se demande si les animaux ont des droits et nous des devoirs à leur égard (si oui, pourquoi et lesquels ?), s’ils méritent tous notre considération morale (si non, au nom de quoi exclure certaines espèces ?) et quelles en sont les conséquences pratiques, en termes d’alimentation, de recherche scientifique, de divertissements et, plus largement, de projet de société. Il s’agit donc d’un ensemble de questions et non pas, comme on le croit trop souvent, d’une compilation de règles idéales, ou de recettes sur ce qu’il est « moral » de faire aux animaux. Cela n’a pas de sens, de ce point de vue, de demander si telle ou telle pratique est « conforme à l’éthique animale », car l’éthique animale n’est pas une charte sur laquelle tout le monde serait d’accord, mais un domaine de recherche dans lequel, au contraire, beaucoup de personnes sont en désaccord.
La réflexion sur le statut moral des animaux est millénaire (Jeangène Vilmer, 2011b), mais ce n’est qu’à partir de la fin du XIXe siècle qu’elle se présente sous le nom d’ « éthique animale », et seulement depuis les années 1970 dans le monde anglophone que l’inflation des publications et les premiers enseignements universitaires la consolident comme un domaine de recherche à part entière, voire une sous-discipline académique, au sein de l’éthique appliquée.
Il faut à ce titre la distinguer de ses voisines que sont notamment la bioéthique et l’éthique environnementale. La bioéthique, au sens large d’éthique du vivant, inclut par définition l’éthique animale puisque les animaux sont vivants, mais dans les faits elle se limite surtout à des questions de biomédecine et de technosciences qui ne concernent pas directement notre relation avec les autres animaux. Elles les concernent indirectement bien entendu, à travers les débats sur l’expérimentation animale, les animaux transgéniques ou les xénogreffes par exemple. Mais ce ne sont là que certaines des questions pratiques auxquelles s’intéresse l’éthique animale, qui a aussi un volet théorique.
La différence avec l’éthique environnementale est claire si l’on prend conscience que tous les animaux ne font pas partie de ce que l’on appelle « l’environnement » et, inversement, que tous les problèmes environnementaux ne concernent pas les animaux. Ici encore, les relations sont indirectes, lorsque l’élevage industriel, par exemple, pose à la fois des problèmes d’éthique animale au sens strict, c’est-à-dire à l’égard des animaux pris individuellement (est-il légitime de les exploiter et de nuire autant à leur bien-être ?), et des problèmes d’éthique environnementale puisqu’il est désormais établi que la production de viande et de lait pollue les sols, l’air, l’eau, contribue aux pluies acides, à la déforestation, au réchauffement climatique et nuit à la biodiversité.
En dépit de ces intersections, ce qui distingue profondément ces deux domaines est à la fois que l’éthique animale, d’une part, considère généralement la souffrance et, dans certains cas, la mort elle-même comme des maux à éviter tandis que l’éthique environnementale les banalise comme faisant partie de « la nature » et, d’autre part, a une approche individualiste – puisque seuls les individus souffrent – tandis que l’éthique environnementale est holiste, elle attribue des intérêts à des catégories comme les espèces, les écosystèmes et même « la terre ». Les deux ont depuis plusieurs décennies une relation complexe, certains tentant de montrer qu’elles sont irréconciliables, d’autres qu’elles peuvent être dans une certaine mesure compatibles (Johnson, 1981 ; Hargrove, 1992 ; Callicott 2010).
L’éthique animale a donc une identité propre au sein de l’éthique appliquée. Le but de cet article est d’en présenter brièvement les contours, les courants et les principaux thèmes. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut revenir sur son développement et les raisons pour lesquelles il a été et est encore très différent selon le contexte culturel, en l’occurrence si l’on compare le cas de la France avec celui des pays anglophones.
Humanisme français versus éthique animale anglophone
C’est dans le monde anglophone que l’éthique animale est perçue comme une discipline, qu’elle est enseignée à l’université aux philosophes, aux juristes, aux vétérinaires, aux étudiants en sciences animales, et qu’elle donne lieu à la plus formidable production bibliographique. La France produit également, et depuis toujours, des philosophes de qualité qui s’intéressent au statut moral des animaux : une incursion historique prouverait que Jean-Claude de la Métherie, par exemple, défendait deux ans avant Bentham l’égalité animale et l’antispécisme avec une grande clarté (Jeangène Vilmer, 2011b, p. 101-107), ou que les premiers à défendre l’idée que les animaux sont des personnes sont des philosophes et des juristes français au XIXe siècle (L. Brothier en 1863, P. Janet en 1869, E. Engelhardt en 1899, L. Lespine en 1928, dans J.-B. Jeangène Vilmer, 2011b). Et, aujourd’hui encore, de nombreux travaux peuvent témoigner de la vigueur de l’éthique animale francophone (F. Armengaud, F. Burgat, G. Chapouthier, J.-Y. Goffi, C. et R. Larrère, E. Reus, l’équipe des Cahiers antispécistes, etc.).
Mais le fait est que cette réflexion est beaucoup moins systématisée, productive et reconnue que dans les pays anglophones. L’attitude dominante consiste plutôt à dénoncer « cette idéologie "animaliste" anglo-saxonne qui nous menace et dont l’aveuglement et la violence font déjà des ravages ici ou là », comme le dit par exemple Francis Wolff (2007b), qui consacre le premier chapitre de sa Philosophie de la corrida à caricaturer et dénigrer l’éthique animale telle qu’elle se fait, selon lui, outre-Manche et outre-Atlantique (Wolff, 2007a). Lors d’une émission sur France Culture en janvier 2011, à laquelle je participais, les journalistes ont pouffé de rire lorsqu’Yves Christen a dit « quelqu’un » en parlant d’un chimpanzé, comme s’il était évident qu’il ne pouvait pas être une personne, puisqu’il était un animal ! (« Les animaux font-ils les frais de l’humanisme ? », Du grain à moudre, France Culture, 18 janvier 2011). Plus d’un siècle et demi après les premiers débats philosophiques et juridiques sur la personnalité des animaux, la résistance est immense.
Si elle est plus forte en France qu’en Angleterre ou aux Etats-Unis, c’est d’abord parce qu’elle s’ancre dans l’humanisme, qui depuis Descartes non seulement domine les études philosophiques mais aussi définit « l’esprit français », c’est-à-dire l’image que la France aime se donner d’elle-même. Elle est convaincue, en particulier, d’être la-patrie-des-droits-de-l’homme – parce que quelques personnages flamboyants se servent du « droit-de-l’hommisme » pour leur promotion personnelle et que les médias relaient davantage cette image d’Epinal que la vingtaine de condamnations annuelles de la France par la Cour européenne des droits de l’homme. Les historiens, les juristes et les philosophes qui se sont penchés sur la question savent bien que la France n’est pas davantage « la » patrie des droits de l’homme que l’Angleterre ou les Etats-Unis – mais cela fait partie de son image morale, ce qu’Aristote appelait son ethos.
Il est donc politiquement correct, et même quasi obligatoire, de se dire « humaniste », parce qu’on a la vague impression qu’il s’agit de défendre les droits de l’homme – et qui pourrait être contre une si noble cause ? Mais être humaniste, c’est aussi et surtout défendre la supériorité de cet humain, que Descartes invitait à se rendre « comme maître et possesseur de la nature » (Discours de la méthode, 1637, VI). Etre humaniste, c’est s’indigner que l’on puisse même penser à donner des droits aux animaux, pour la seule et unique raison qu’ils ne sont pas humains. Et c’est placer l’homme et l’animal dans des vases communicants, en se persuadant qu’augmenter la considération pour l’un rabaisse l’autre de façon mécanique.
Comme s’il n’était pas possible d’être pour les animaux sans être contre l’homme ! Comme si ces deux objectifs étaient contradictoires ! Comme si l’histoire n’était pas pleine de ces hommes qui, comme Gandhi et Schweitzer, comme William Wilberforce qui a été l’un de ceux à l’origine de l’abolition de l’esclavage dans l’Empire britannique tout en contribuant à la création de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ont mené les deux de front. Comme s’il n’était pas évident qu’être plus « humain » avec les animaux nous rendait plus « humain », précisément, pas moins.
C’est donc la persistance de l’humanisme qui, en France, est le premier obstacle philosophique au développement de l’éthique animale. Tandis que, dans le monde anglophone, dominé plutôt par la tradition utilitariste, on peut poser la question du statut moral des animaux sans avoir l’impression d’écorner ce que Ferry appelle « L’homme-dieu » (Ferry, 1996, p. 241). On peut donc travailler sur l’animal comme sur n’importe quel autre objet philosophique, sans se faire accuser de crime de lèse-humanité.
Il y a en outre des raisons plus spécifiques qui expliquent le retard français : des raisons culturelles (le rôle identitaire de la gastronomie, les « exceptions culturelles » comme la corrida ou le foie gras) et politiques (l’importance du secteur agricole, la puissance des lobbys de l’industrie agro-alimentaire, la surreprésentation des chasseurs au parlement et des aficionados au gouvernement).
Dans ce contexte, l’éthique animale est souvent incomprise en France. On la décrit volontiers comme une dangereuse importation « anglo-saxonne » à laquelle il faut résister gauloisement, et comme une « théorie » unifiée alors qu’il s’agit d’un champ de recherche extrêmement diversifié. On dresse un portrait caricatural des rares auteurs que l’on connaît, comme Peter Singer, dont on dit généralement qu’il est pour l’infanticide, l’euthanasie des handicapés et l’eugénisme – des aberrations véhiculées par ceux qui ne l’ont jamais lu. Et, surtout, on accuse les défenseurs des animaux de sentimentalisme et de sensiblerie.
Nombreux sont les auteurs, en effet, qui, comme Luc Ferry, Janine Chanteur ou Jean-Pierre Digard, se présentent comme des alternatives sérieuses et rationnelles au sentimentalisme ridicule des « amis des bêtes » (Ferry, 1992 ; Chanteur, 1993 ; Digard, 2009). Sans doute confondent-ils les plaidoyers larmoyants de certaines personnalités, les tracts sensationnalistes de certaines associations et les théories des philosophes et des juristes qui pensent l’éthique animale. Sans doute n’ont-ils pas lu les auteurs anglophones – même les plus connus, qui sont traduits en français, comme Singer, Regan et Francione. Car s’ils l’avaient fait, ils les auraient trouvés bien moins sentimentaux et surtout bien plus rationnels que ceux qui défendent l’anthropocentrisme moral en se basant uniquement sur des préjugés ou un catalogue de philosophes classiques (sophisme de l’appel à l’autorité), comme on a trop tendance à le faire en France. Élisabeth de Fontenay, d’ailleurs, ne s’y est pas trompée, elle qui critique le « logicisme » et la « confiance dans la déduction, voire dans le syllogisme » de Singer et Cavalieri, auquel elle oppose son approche de la « sagesse de l’amour » et sa préférence pour les « fragments de pensée non démonstrative » (De Fontenay, 2000, p. 146 et 149).
Il y a en vérité deux manières de faire de l’éthique animale, deux approches : par la justice et par la compassion.
Justice versus compassion
L’approche par la justice observe que ceux qui disent « aimer » les animaux, avoir à leur égard des sentiments, ne sont pas souvent cohérents. En 1763, Oliver Goldsmith écrivait déjà : « Les honnêtes gens se piquent ici d’avoir une extrême compassion pour toutes sortes d’animaux : à les entendre, un étranger s’imaginerait qu’ils n’ont pas le courage de nuire à un moucheron qui les pique. […] Et cependant, le croira-t-on ? J’ai vu ces mêmes hommes, qui affectent tant de commisération, dévorer six différents animaux, apprêtés par leurs cuisiniers. Étrange contradiction ! ils plaignent, et ils mangent les objets de leur pitié » (Goldsmith, 1763, p. 75). Dans la préface d’Animal Liberation (1975), Peter Singer rapporte une anecdote similaire : une femme lui dit combien elle « aime » les animaux – elle tient un hôpital pour chiens et chats – tout en mangeant un sandwich au jambon (Singer, 1993). Singer, lui, n’« aime » pas les animaux, mais il ne les mange pas non plus, car il est avec eux dans une relation de justice, non de compassion.
Cette sorte de « schizophrénie morale » (Francione, 2010, p. 196) qui fait que nos sentiments à l’égard des bêtes se portent inégalement en fonction des espèces – nous reprochons aux Chinois de manger les chiens mais nous trouvons tout à fait normal de manger les cochons, qui ne sont pourtant pas moins sensibles, et probablement plus intelligents, que les chiens – s’appelle le spécisme. Ce néologisme créé en 1970 par la psychologue britannique Richard Ryder qualifie la discrimination selon l’espèce, sur le modèle de « racisme » (selon la race) et « sexisme » (selon le sexe) (Ryder, 1983, p. 5).
Le problème des sentiments est qu’ils sont inégalement répartis non seulement en fonction des espèces, mais aussi chez chacun d’entre nous. Certains sont « sensibles » à la cause animale, d’autres pas. Ceux qui écrivent pour convaincre ne pourront jamais toucher qu’une partie de leur lectorat s’ils adoptent une approche compassionnelle, et risquent en outre de se mettre à dos tous ceux qui récusent la « sensiblerie ». L’approche par la justice, au contraire, s’en remet non pas aux sentiments mais au bon sens de ses destinataires, un bon sens entendu ici comme une capacité d’être sensible à l’argumentation rationnelle. Ses partisans présument que, comme disait Descartes, il est « la chose du monde la mieux partagée » (Discours de la méthode, 1637, I, 1) – ce qui est discutable.
Il y a une meilleure raison de préférer l’approche par la justice. Ceux qui « aiment » les animaux sont généralement animés par ce que Regan appelle un « devoir direct de bonté envers les animaux » (Regan, 2010, p. 170). Or, la bonté, comme la compassion, peut se donner mais ne s’exige pas. Elle ne permet pas de rendre compte du fait que le respect des animaux leur est dû, précisément parce que, critique Regan, « la bonté n’est pas la justice » (Regan, 1983, p. 199).
L’approche par la justice s’adresse à la raison, elle est abstraite, vise la cohérence, applique des règles générales et cherche à trouver une solution juste au sens d’équitable à un dilemme moral ou un conflit d’intérêt. L’approche par la compassion s’adresse aux sentiments, elle est plus concrète, s’attache à des cas particuliers, s’occupe essentiellement des émotions ressenties par sympathie et vise la satisfaction des besoins.
La plupart des acteurs de l’éthique animale anglophone adoptent une approche par la justice, en particulier ceux qui défendent une théorie des droits des animaux, mais aussi les conséquentialistes qui ne parlent pas de droit. Les uns comme les autres privilégient l’argumentation rationnelle et partent du « principe de justice » selon lequel les cas similaires doivent être traités de manière similaire : il est injuste, de ce point de vue, de discriminer les animaux « parce qu’ils sont des animaux » et non en fonction de leurs caractéristiques particulières.
C’est ce que James Rachels appelle l’individualisme moral (Rachels, 1991, p. 171). Par exemple, plutôt que de permettre l’usage d’un chimpanzé pour une expérience au cours de laquelle il sera sacrifié, en vertu du fait qu’il appartient au groupe des animaux, et de ne pas permettre l’usage d’un homme pour la même expérience, en vertu du fait qu’il appartient au groupe des humains (et que l’on confère à ce groupe une dignité spécifique), il faudrait se demander ce qui justifie l’usage de ce chimpanzé particulier, et non de cet humain particulier, selon leurs caractéristiques respectives, indépendamment de leur appartenance à une espèce.
Les humanistes français ont vite fait de répondre en faisant appel à la « dignité humaine ». Cette notion est une construction, comme l’expliquent bien Adorno et Horkheimer : « Dans l’histoire européenne, l’idée de l’homme s’exprime dans la manière dont on le distingue de l’animal. Le manque de raison de l’animal sert à démontrer la dignité de l’homme » (Horkheimer et Adorno, 1974, p. 268). Un manque de raison d’ailleurs contestable puisque les éthologues ont montré que certains animaux étaient tout à fait capable de raisonner – ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de tous les humains.
« Ce qui m’est si suspect dans l’éthique kantienne, poursuit Adorno, est la "dignité" qu’elle accorde à l’homme au nom de l’autonomie. La faculté à s’auto-déterminer moralement est attribuée aux hommes comme un avantage absolu – comme un profit moral – et l’on en fait en secret une prétention à la maîtrise – à la maîtrise sur la nature. […] Elle est dirigée contre les bêtes. Elle exclut tendanciellement l’homme de la création et de ce fait menace incessamment son humanité de se retourner en inhumanité » (Adorno, 2011).
L’approche par la justice estime qu’il serait illogique et incohérent de faire de la dignité le privilège exclusif de l’animal humain, et l’approche par la compassion que l’homme n’est digne que s’il fait preuve de sentiment – on dit aussi d’ « humanité » – à l’égard des autres animaux. Le compositeur Richard Wagner, qui n’a pas écrit que de la musique, expliquait en 1879 qu’« au point de vue de la DIGNITE HUMAINE, (…) celle-ci ne se manifeste que là où l’homme peut se différencier de l’animal par la pitié qu’il aurait pour l’animal même » (Wagner, 1925, p. 28).
Aujourd’hui, l’approche par la compassion est représentée en éthique animale par ceux qui s’inscrivent dans la tradition de l’éthique du care (on parle en français d’éthique de la sollicitude ou du soin), qui est un exemple contemporain d’éthique de la vertu, souhaitant réhabiliter en philosophie morale des sentiments, considérés comme des vertus, tels que le soin, l’attention, la sollicitude, la gentillesse, la générosité, l’amabilité, etc.
« Mon opposition à l’exploitation institutionnalisée des animaux, explique Luke, n’est pas fondée sur une comparaison entre le traitement des humains et des animaux, mais sur la prise en compte du tort causé aux animaux en lui-même. Je réagis directement aux besoins et à la situation des animaux utilisés dans la chasse, l’élevage et la vivisection. Lorsque je m’oppose à ces pratiques, je ne suis pas en train de comparer le traitement des humains et des animaux en pensant "ceci est injuste car les humains sont protégés d’un tel usage". Je suis horrifié par les abus commis en eux-mêmes […]. Ma condamnation morale de ces actions provient directement de ma sympathie pour les animaux ; elle est indépendante de la question de savoir si les humains sont protégés de tels abus » (Luke, 1999).
Les travaux de Steve Sapontzis et Stephen Clark en anglais, Jean-Yves Goffi en français et Jean-Claude Wolf en allemand s’inscrivent dans cette tradition (Jeangène Vilmer, 2011b), ainsi que tout le courant féministe en éthique animale (Adams et Donovan, 1995). Ils divergent quant au contenu, mais partagent cette même priorité de la sympathie sur l’argumentation rationnelle. De la même manière, ceux qui défendent l’approche par la justice, c’est-à-dire la priorité de l’argumentation rationnelle sur la sympathie, s’opposent très clairement à plusieurs titres, comme la tradition philosophique à laquelle ils appartiennent en éthique (déontologisme versus conséquentialisme) ou leurs objectifs pratiques (abolitionnisme versus welfarisme) – cette dernière division concernant tout aussi bien les partisans de la justice que ceux de la compassion.
Abolitionnisme versus welfarisme
L’éthique animale étant l’un des sous-domaines de l’éthique appliquée, elle a par définition une visée pratique : il s’agit de savoir ce qu’il faut changer dans notre relation avec les autres animaux, et pourquoi. C’est là qu’intervient la grande fracture des objectifs : certains s’opposent au fait d’exploiter les animaux (abolitionnistes), d’autres à la manière de le faire (welfarisme). Le but des premiers est d’abolir l’exploitation, celui des seconds d’améliorer le bien-être animal.
J’ai eu avec Elisabeth de Fontenay un débat sur l’utilisation du terme « abolitionnisme », qui est assez révélateur de l’incompréhension française que l’on dénonçait tout à l’heure (Vivre avec les bêtes, France Inter, 13 mars 2011). De Fontenay dépend des droits pour les animaux mais elle reste dans une perspective classique anthropocentriste et humaniste. Elle trouve donc choquant d’utiliser le mot « abolitionnisme » au sujet des animaux, puisqu’il renvoie en principe à l’abolition de l’esclavage – et devrait pour elle en rester à cette sphère humaine. C’est assez curieux, en vérité, car le mot « abolitionnisme » n’est a priori réservé à aucune sphère : il désigne simplement l’abolition de quelque chose. Les mêmes au XIXe siècle parlaient d’abolitionnisme pour l’esclavage et la vivisection. Aujourd’hui, les opposants à la peine de mort se disent abolitionnistes. Le mot n’est pas réservé, même s’il est historiquement chargé – et utilisé en vertu de cette charge, précisément, qui permet aux abolitionnistes en éthique animale de faire le parallèle entre l’abolition de l’exploitation des animaux qu’ils appellent de leurs vœux et celle de l’esclavage humain.
Le welfarisme s’inscrit quant à lui dans une démarche réformiste, poursuivant pas à pas des objectifs circonscrits, jugés accessibles à court ou moyen terme. Ces réformes peuvent cependant inclure l’abolition pure et simple de certaines pratiques, comme l’élevage en batterie, les corridas, l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques, l’expérimentation animale pour les cosmétiques et les produits d’entretien, les chirurgies électives sur les animaux de compagnie (coupe des oreilles, de la queue ou le retrait des griffes), etc.
Les deux – abolitionnisme et welfarisme – sont clairement opposés sur le plan des objectifs, mais pas nécessairement sur le plan des moyens. Car il existe des abolitionnistes welfaristes, qui ont une approche graduelle : sans renoncer à l’objectif d’abolir, à terme, l’exploitation animale, ils incluent le welfarisme comme une étape intermédiaire. Ils militent donc, par exemple, pour l’abolition des œufs de poules en batterie, comme une première étape. Ils rejoignent alors temporairement les welfaristes – qui n’iront pas plus loin puisqu’ils ne voient pas le problème dans le fait d’exploiter une poule si les conditions sont réunies pour qu’elle exprime un comportement naturel, qu’elle a de l’espace et que sa souffrance est minimisée.
Il existe aussi des abolitionnistes anti-welfaristes qui sont convaincus que réformer l’exploitation la rend plus acceptable et réduit donc les chances de pouvoir un jour l’abolir. « Quand vous réformez l’injustice, explique Regan, mon opinion est que vous la prolongez » (Regan, 1992). Ce sont eux qui s’appuient souvent sur la comparaison avec l’esclavage, puisque celui-ci n’a pas été « humanisé » dans une perspective welfariste mais purement et simplement aboli. Gary Francione est le chef de file de ce mouvement, et il s’en prend vigoureusement aux abolitionnistes welfaristes, qu’il appelle des « néo-welfaristes » (ignorant ainsi qu’ils partagent le même objectif d’abolir l’exploitation à long terme).
Cette double fracture dans l’objectif (abolitionnisme versus welfarisme) et les moyens (abolitionnisme welfariste versus abolitionnisme anti-welfariste) transcende les approches philosophiques, c’est-à-dire la manière par laquelle chaque auteur arrive à la conclusion de ce qu’il « faut » faire. Il y a des welfaristes spécistes, qui relèvent de la défense animale (Élisabeth de Fontenay) et des welfaristes antispécistes, qui relèvent de la libération animale (Peter Singer). Il y a des abolitionnistes anti-welfaristes déontologistes (Gary Francione) et des abolitionnistes welfaristes conséquentialistes (en France, Estiva Reus par exemple, qui pense que rien ne prouve que Singer ne soit pas un abolitionniste welfariste. Il me semble au contraire qu’il n’a aucune raison théorique d’être abolitionniste et que, jusqu’à preuve du contraire, il ne condamne jamais l’exploitation en tant que telle). En général, les abolitionnistes défendent une théorie des droits, mais pas nécessairement.
Droits versus intérêts des animaux
Croire que l’éthique animale se réduit à la défense des « droits des animaux » est l’un des préjugés les répandus à son égard. Il y aurait, d’un côté, les « animalistes » affirmant que les animaux ont des droits et, de l’autre, les humanistes affirmant que ce n’est pas le cas. En réalité, tous les « animalistes » ne défendent pas une théorie des droits et cela ne les empêche pas de défendre les intérêts des animaux. Quant aux humanistes, ils vont vite en besogne lorsqu’ils affirment que les animaux n’ont pas et ne peuvent pas avoir de droits, puisque le fait est qu’ils en ont déjà, et c’est toute l’ambiguïté de cette notion.
Les animaux, ont effet, ont des droits depuis qu’ils sont protégés par la loi, par l’article 521-1 du Code pénal français, par exemple, qui punit « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Si nous avons le devoir de ne pas maltraiter ces animaux de la sorte, on peut dire qu’ils sont titulaires d’un droit à ne pas l’être. Ceux qui, aujourd’hui, militent en faveur des « droits des animaux » ne parlent pas de ces droits déjà existants, qu’ils jugement insuffisants, mais de droits plus fondamentaux – comme le droit à la vie, ou à n’être pas torturé – qui n’existent pas encore, et qui doivent donc être développés dans le cadre d’une éthique animale.
Le problème, objecteront les humanistes, est que les droits impliquent toujours des devoirs réciproques et que les animaux en question sont incapables de le comprendre et d’avoir de tels devoirs : c’est donc qu’ils n’ont pas de droits. C’est une objection antique, basée sur le constat que « l’animal » n’est pas rationnel : la rationalité des agents serait une condition nécessaire à la relation de justice, soit parce que la justice est un contrat social (épicuriens), soit parce que sa source, l’oikeiôsis (appropriation), implique la rationalité (stoïciens). L’argument est toujours aussi populaire aujourd’hui. La réponse, pourtant, est simple.
On pourrait discuter de l’irrationalité de « l’animal » (une abstraction construite par nous pour intégrer des espèces aussi diverses que l’éponge et le chimpanzé dans un même ensemble, tout en excluant l’animal humain), que les éthologues contesteraient aisément : la rationalité n’est pas un attribut binaire qui serait soit tout à fait présent, soit tout à fait absent, mais un dégradé, autant chez les hommes que chez les autres animaux, et on en trouve des traces chez certains animaux non humains. Les Grecs anciens n’avaient d’ailleurs pas attendu les découvertes récentes de l’éthologie pour l’établir, puisque Théophraste, Plutarque et Galien, par exemple, pensaient que les animaux étaient rationnels.
Mais peu importe, car le cœur de la réponse n’est pas là. Il consiste plutôt à dire que, si la rationalité, ou des capacités cognitives quelconques (comme la « conscience », une autre abstraction créée pour séparer l’homme des autres animaux), étaient vraiment le critère de la considération morale, de la possession de droits, alors de nombreux humains – les nourrissons, même les enfants jusqu’à un certain âge, les handicapés mentaux profonds, les séniles, les comateux – devraient ne pas recevoir de considération morale et ne pas posséder de droits. Or ce n’est pas le cas. C’est donc que la rationalité ou les capacités cognitives n’y sont pour rien. C’est ce que l’on appelle l’argument des cas marginaux.
Sans l’utiliser explicitement, les juristes du siècle dernier l’avaient déjà compris : « les législations actuelles, pas plus que la législation romaine, ne font dépendre la personnalité juridique des aptitudes intellectuelles des justiciables », note Engelhardt en 1899, tandis que Garnot ajoute en 1934 que « restreindre à l’homme le privilège de la personnalité est une erreur, parce qu’il n’est pas seul à avoir un intérêt à défendre » (Engelhardt, 1900, p. 86 et Garnot, 1934, p. 173-187).
Avoir un intérêt à défendre : là est le critère que l’on cherche. « Dire qu’un être est une personne, explique Francione, c’est simplement dire que l’être a des intérêts moralement significatifs, que le principe d’égale considération s’applique à cet être, que cet être n’est pas une chose » (Francione, 2000, p. 100-101). Pour certains (Francione, Regan, Linzey et beaucoup d’autres), ces intérêts fondent des droits. Pour d’autres, comme Singer, il vaut mieux éviter le vocabulaire des droits, qui « représente un raccourci politique pratique […] mais dans l’argumentation en faveur d’un changement radical dans notre attitude envers les animaux, ce langage n’est en rien nécessaire » (Singer, 1993, p. 38). La question des droits des animaux, renchérit Frankena, un autre utilitariste, n’est ni « très importante ni […] substantielle » (Frankena, 1995, p. 119). Singer consacre d’ailleurs un article à expliquer pourquoi « la différence philosophique entre ceux qui, à l’instar de Regan, fondent leur défense des animaux sur la revendication de leurs droits, et ceux qui, comme moi, ne le font pas » est fondamentale (Singer, 2010, p. 138).
Il y a encore bien d’autres courants dont il faudrait parler – dont l’approche par les capabilités de Martha Nussbaum ; ceux qui, comme Clark et Sapontzis, basent leur défense des animaux sur l’intuition et la moralité courante plutôt que sur des théories sophistiquées ; ou encore des pragmatistes qui tentent de dépasser les oppositions rigides entre les uns et les autres – mais ce rapide tour d’horizon suffit à montrer que, derrière la question de société polémique qui mobilise les militants et passionne une partie de la population, il y a un domaine de recherche dynamique et diversifié, l’éthique animale, que l’on gagnerait à mieux connaître.
Bibliographie
Adams C. et J. Donovan (éd.), Animals & Women, Durham, Duke University Press, 1995.
Adorno, T. Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte, Frankfurt, Suhrkamp, 1993, in J.-B. Jeangène Vilmer, Anthologie d’éthique animale. Apologies des bêtes, Paris, PUF, 2011, p. 273.
Callicott, J. B. « Libération animale et éthique environnementale : de nouveau ensemble », trad. H.-S. Afeissa et C. Larrère, in H.-S. Afeissa et J.-B. Jeangène Vilmer (dir.), Philosophie animale. Différence, responsabilité et communauté, Paris, Vrin, 2010, p. 309-331.
Chanteur, J. Du droit des bêtes à disposer d’elles-mêmes, Paris, Seuil, 1993.
De Fontenay, E. « Pourquoi les animaux n’auraient-ils pas droit à un droit des animaux ? », Le Débat, 109, 2000, p. 138-155.
Digard, J.-P. « Raisons et déraisons des revendications animalitaires », Pouvoirs, 131, 2009, p. 97-111.
Engelhardt, E.-P. De l’animalité et de son droit, Paris, Chevalier-Marescq, 1900.
Ferry, L. Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Paris, Grasset, 1992.
Ferry, L. L’homme-Dieu ou le sens de la vie, Paris, Grasset, 1996.
Francione, G. Introduction to Animal Rights, Philadelphia, Temple University Press, 2000.
Francione, G. « Prendre la sensibilité au sérieux », in H.-S. Afeissa et J.-B. Jeangène Vilmer (dir.), Philosophie animale. Différence, responsabilité et communauté, Paris, Vrin, 2010, p. 185-221.
Frankena, W. « Il diritto alla vita degli esseri non-umani » (1983), trad. in A. Bondolfi, L’homme et l’animal : dimension éthique de leur relation, Fribourg, Éditions universitaires, 1995, p. 112-131.
Garnot, M.-J. Les animaux bénéficiaires de libéralités, thèse de doctorat, Les Presses Bretonnes, 1934.
Goldsmith, O. Le citoyen du monde I, lettre XV, Amsterdam, J.F. Boitte et Cie, 1763.
Hargrove, E. C. (ed.). The Animal Rights/Environmental Ethics Debate : The Environmental Perspective, Albany, State University of New York Press, 1992.
Horkheimer, M. et T. Adorno, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1974.
Jeangène Vilmer, J.-B. L’éthique animale, Paris, PUF, 2011 (2011a).
Jeangène Vilmer, J.-B. Anthologie d’éthique animale. Apologies des bêtes, Paris, PUF, 2011 (2011b).
Johnson, E. « Animal Liberation versus the Land Ethic », Environmental Ethics, 3, 1981, p. 265-273.
Luke, B. « Justice, sollicitude et libération animale », Cahiers antispécistes, n° 17, avril 1999, en ligne.
Rachels, J. Created from Animals, Oxford, Oxford University Press, 1991.
Regan, T. The Case for Animal Rights, Berkeley, University of California Press, 1983.
Regan, T. Interview, Cahiers antispécistes, 2 janvier 1992, en ligne.
Regan, T. « Pour les droits des animaux », in H.-S. Afeissa et J.-B. Jeangène Vilmer (dir.), Philosophie animale. Différence, responsabilité et communauté, Paris, Vrin, 2010, p. 161-183.
Ryder, R. Victims of Science (revised edition), Fontwell, National Anti-Vivisection Society, Centaur Press, 1983.
Singer, P. La libération animale, Paris, Grasset, 1993.
Singer, P. « Libération animale ou droits des animaux ? », in H.-S. Afeissa et J.-B. Jeangène Vilmer (dir.), Philosophie animale. Différence, responsabilité et communauté, Paris, Vrin, 2010, p. 137-160.
Wagner, R. Lettre à A. E. von Weber, octobre 1879, in Œuvres en prose de Richard Wagner, Paris, Delagrave, 1925, t. XIII.
Wolff, F. Philosophie de la corrida, Paris, Fayard, 2007 (2007a).
Wolff, F. « Gare à l’idéologie animaliste », L’Humanité hebdo, 15 septembre 2007, p. 18 (2007b).


